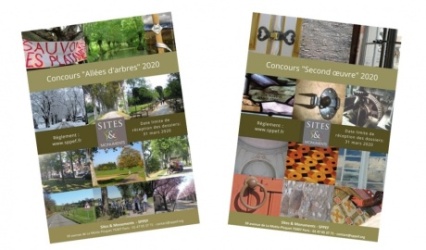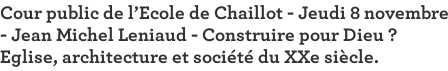Auditorium de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine - Cours Publics de l’Ecole de Chaillot à 18h30 - cycle "Construire pour le culte. Projets artistiques et techniques au XXe siècle"
Conférence introductive du 13ème cycle des Cours Publics.
Par : Jean-Michel Leniaud, historien de l’art, directeur d’études, EPHE, directeur de l’Ecole de Chartes (2011-2016)
Le Concordat napoléonien imposa un carcan aux constructions d’églises en inventant le principe d’une architecture normée d’où émergent quelques chefs-d’œuvre marqués par les styles historiques. La Séparation introduisit la liberté de construire où et comme on l’entendait. Il fallait répondre au déficit de paroisses imposé par le siècle précédent, aux ruines des guerres, au développement de la banlieue, à l’exode rural. Il importait aussi de tenir sa partie dans le contexte des évolutions et des crises de l’architecture : la modernité, le refus d’une architecture durable, le retour au monumental.
Mais plus encore, s’imposait la nécessité de répondre aux interrogations que l’Église se posait sur elle-même : mission de la paroisse, théologie de l’enfouissement, voire de la sécularisation, affirmation de la visibilité. Malgré des moyens modestes, Il en est résulté des chefs-d’œuvre que la société civile envie à la société religieuse. Le XXe siècle autant que les deux premières décennies du XXIe siècle y trouvent l’expression de leurs aspirations esthétiques, parfois sans vouloir se l’avouer.
Pendant que les Catholiques, soucieux de s’adapter aux transformations que dicte la modernité, n’hésitent pas à détruire pour reconstruire ailleurs et autrement, les instances publiques ne cessent d’intervenir pour imposer des patrimonialisations dont elles ne se soucient pas toujours pour leur propre parc immobilier. Un chapitre nouveau des relations contrastées entre Dieu et César commence s’écrire sous nos yeux.
Inscription : https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/construire-pour-dieu-eglise-architecture-et-societe-au-xxeme-siecle